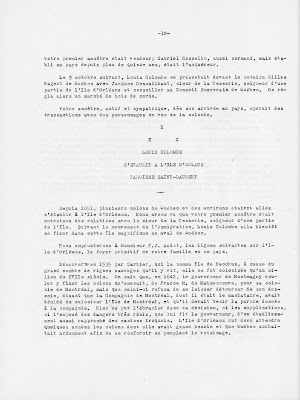Jean Coulombe deuxième fils de Louis Coulombe, notre premier ancêtre né au pays, traversa le fleuve pour se marier le 27 avril 1706 dans la paroisse Saint-Thomas de Montmagny, alors connue sous le nom de Saint-Thomas-de-la-Pointe-à-la-Caille. Il épousait Jeanne Balan, fille de Pierre Balan dit La combe et de Renée Birette.
Après son mariage, Jean Coulombe alla s'établir sur une terre de la paroisse de Berthier-en-bas faisant partie de la Seigneurie de Bellechasse. Il s'établit dans le secteur connu comme Saint-Pierre de la Rivière du Sud.
Ils eut un total de onze enfants, trois fils d'un premier lit, avec Jeanne, dont notre ancêtre François né en 1712.
Données historiques sur la paroisse
L'histoire de Berthier-sur-Mer commence avec la concession au célèbre intermédiaire et interprète Nicolas Marsolet de Saint-Aignan, le 28 mars 1637, d'une bande de terre d'un quart de lieue de largeur sur une lieue et demie de profondeur avec façade sur l'Anse de Bellechasse. Cette partie de la paroisse demeure encore connue de nos jours, sous l'appellation de «Micami» transmise par la tradition orale qui mentionne aussi un «sentier des indiens» reliant le fleuve Saint-Laurent à la Rivière-du-Sud. Ses occupations de commerce et de traite, maître de barque et trafiquant semblent ne lui avoir laissé guère de temps pour remplir son obligation première de «Seigneur» soit le recrutement et l'établissement de défricheurs et colons. Le 15 novembre 1672, il acceptait de rétrocéder sa seigneurie de «Belle chasse› concédée et agrandie à deux lieues de front sur pareille profondeur par l'intendant Jean Talon au Sieur Alexandre de Berthier, capitaine du Régiment de Carignan. Le seigneur poursuivit sa carrière militaire et s'impliqua aussi dans la traite des fourrures. Avant de repartir en expédition contre les Iroquois sous le commandement de Frontenac, il engagea Pierre Bazin comme fermier pour s'occuper de sa seigneurie. Lors du recensement de 1681, Pierre Bazin, son épouse et ses cinq enfants se retrouvèrent au début de la liste des habitants de la Seigneurie de «Belle Chasse» dont le nombre était de 18 personnes. Après la mort d'Alexandre, l'aîné des fils du capitaine de Berthier, la jeune veuve âgée de 16 ans hérita de la Seigneurie de Belle Chasse-Berthier. En 1706, elle fit une donation pour y placer l'église, le cimetière et le presbytère.
De 1672 à 1845, les seigneurs se succédèrent et en 1845 une proclamation du gouverneur Metcalfe nommait d'autorité les membres du premier conseil municipal à siéger à Berthier.
La municipalité étant située sur le bord du fleuve et ayant des abris naturels les principales occupations des habitants étaient l'agriculture et la navigation dont plusieurs capitaines demeuraient à Berthier. Les marins de notre paroisse travaillaient sur de petits bateaux au service du Gouvernement fédéral, sur des dragueurs et de petits cargos. Ils ont toujours eu la réputation d'être courageux, travailleurs adroits de leurs mains et toujours disposés à aider leurs compagnons, mais difficiles à commander et attachés à leurs idées d'une façon tenace, d'où le surnom «Casques de fer».
En 1970, l'appellation de Berthier-en-bas fut changée en Berthier-sur-Mer.
Origine et signification de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
La rivière du Sud, qui a donné son nom, en partie, à cette municipalité de la Côte-du-Sud, dans la région de Montmagny, contribue à la fertilité des terres de la partie nord du territoire. Les rivières Morigeau, des Poitras et le ruisseau de la Blague constituent les principaux éléments du réseau hydrographique de cette entité située entre Montmagny et Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Au cours de 1696, un certain Lecolombier s'installe sur le territoire, mais n'y demeure que très peu de temps. C'est surtout au début du XVIIIe siècle que la colonisation de l'endroit s'effectuera avec la construction d'une chapelle en 1713 au nord de la rivière du Sud, grâce au don d'un terrain par Pierre Blanchet effectué en 1709 et dont la générosité sera prolongée par sa veuve, Marianne Fournier (1713) et son fils Jean en 1716 qui remettront de substantielles donations. Les prêtres de Saint-Thomas desserviront l'endroit couramment désigné de manière abrégée comme Saint-Pierre-du-Sud à la fin du Régime français. Un curé s'installe en ces lieux à partir de 1751, année de la pose de la première pierre de l'église. La reconnaissance des pionniers ne pouvait mieux s'exprimer qu'en plaçant la paroisse, dont les limites ont été fixées en 1722 et qui a été canoniquement érigée en 1848, sous la protection de saint Pierre en l'honneur de Pierre Blanchet. La situation géographique de celle-ci, implantée dans la seigneurie de la Rivière-du-Sud, concédée à Charles Huault de Montmagny en 1646, justifie le choix du spécificatif Rivière-du-Sud